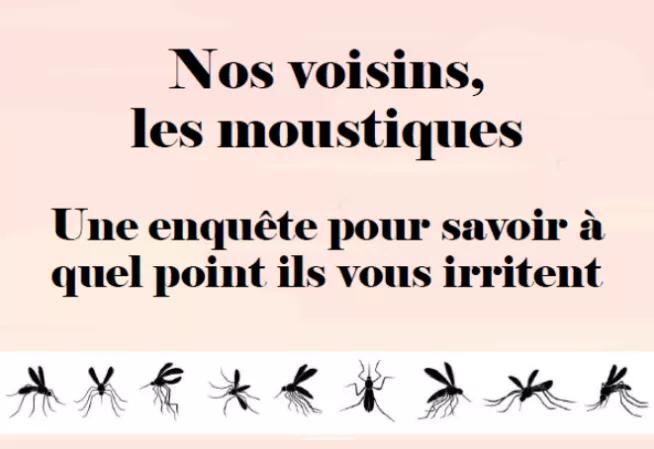Les moustiques sont présents tout autour de nous.La plupart du temps, ils se développent dans notre environnement immédiat (jardin, terrasse, etc.). Il leur suffit juste d’un peu d’eau pour pondre et proliférer, qu’il s’agisse d’une flaque, du fond d’un récipient ou d’un pot de fleurs, d’une gouttière. Ce sont des gestes simples de tous les jours qui permettent de les éliminer.
En Corse, plus de 40 espèces de moustiques sont recensées. Parmi elles, 5 sont susceptibles de transmettre des maladies. On les appelle alors moustique vecteur. C’est le cas de l’anophèle, vecteur du paludisme, du moustique tigre (Aedes albopictus), vecteur de la dengue, du chikungunya ou du zika ou encore du moustique culex, vecteur de la fièvre du Nil (West Nile Fever).
Prévenir l’apparition de maladies liées aux moustiques, et surtout éviter qu’elles ne deviennent épidémiques constitue un enjeu de santé publique croissant, qui nécessite une réponse globale associant à la fois :
- De la surveillance épidémiologique humaine et animale
- De la surveillance entomologique ;
- L’intervention rapide autour des cas ;
- La prévention et la communication ;
- La maladie de la dengue: soyons vigilant
- Une bonne coordination entre les acteurs.
Conseils aux voyageurs
Retour de voyage : attention au chikungunya ! Une épidémie sévit actuellement à La Réunion.
Pour les personnes voyageant et revenant d’une zone de circulation des maladies transmises par les moustiques (notamment La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais également dans les nombreux pays tropicaux) il est fortement recommandé de vous protéger contre les moustiques durant le séjour et d’être attentif à votre état de santé jusqu’à 3 semaines après votre retour.
En cas de doute (fièvre, douleurs articulaires intenses, fatigue, éruptions cutanées...), contactez rapidement un médecin en précisant avoir séjourné dans une zone où circulent les virus
Les moustiques sont présents tout autour de nous et ceux qui nous piquent, ne font pas, en général, un grand trajet : ils se sont développés dans notre environnement proche. Les moustiques, en particulier ceux de l’espèce Aedes albopictus, peuvent se développer dans de toutes petites quantités d’eau : un fond de seau, une gouttière, une flaque persistante, une coupelle de pot de fleurs, etc.
Il existe plusieurs moyens de s’en protéger et le recours systématique aux insecticides n’est pas la meilleure solution. Même s’ils sont agrées, ces produits peuvent être irritants et ne tuent que les moustiques adultes, qui seront remplacés sous quelques jours, par les moustiques présents sous forme de larve. Ces produits peuvent également avoir des effets néfastes sur l’environnement, en particulier tuer ou désorienter les abeilles qui y sont particulièrement sensibles.
Le plus simple et le plus efficace est de supprimer tous les petits points d’eau dans lesquels le moustique peut pondre des œufs et se développer. Il suffit de vider le seau et le retourner, nettoyer la gouttière pour faciliter l’écoulement de l’eau, mettre du sable dans la coupelle.
.

Soyons vigilants …
Le moustique tigre (ou Aedes albopictus) est depuis quelques années implanté et actif en Corse. Il peut transmettre des maladies graves telles que la dengue, le Zika ou le chikungunya. Ces maladies, que l’on appelle arboviroses, peuvent être très invalidantes.
Les deux premiers cas autochtones* de dengue ont été identifiés en Corse en 2022.
*On parle de cas autochtone en Corse quand une personne a contracté la maladie sur le territoire insulaire et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédents l’apparition des symptômes.
Comment attrape-t-on la dengue, le Zika ou le chikungunya ?
Ces maladies ne se transmettent pas directement de personne à personne mais par l’intermédiaire d’un vecteur, le moustique tigre.
Le moustique, en piquant une personne infectée prélève du virus et à l'occasion d'une autre piqûre, le transmet à une personne saine.
Par opposition à un cas importé qui revient d’un séjour dans une zone de circulation de ces maladies, on parle de cas autochtone lorsqu’une personne contracte la maladie sur le territoire sans avoir voyagé.
Quels sont les symptômes ?
Ces maladies, appelées arboviroses se manifestent par une forte fièvre qui apparaît brutalement. Elle est souvent accompagnée de frissons, de maux de tête, de douleurs rétro-orbitaires, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et, de façon inconstante, d'une éruption cutanée vers le 5e jour des symptômes. L’évolution est le plus souvent favorable au bout de quelques jours.
Que faire en cas de symptômes ?
L’ARS Corse rappelle qu’en présence de symptômes évocateurs de la dengue, du Zika ou du chikungunya, en particulier s’ils apparaissent dans les 3 semaines qui suivent le retour d’un voyage en zone de circulation du virus, il est important de se protéger contre les piqures de moustiques, de limiter ses déplacements et d’appeler immédiatement son médecin traitant.
Conseils aux voyageurs
Retour de voyage : attention au chikungunya ! Une épidémie sévit actuellement à La Réunion.
Pour les personnes voyageant et revenant d’une zone de circulation des maladies transmises par les moustiques (notamment La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais également dans les nombreux pays tropicaux) il est fortement recommandé de vous protéger contre les moustiques durant le séjour et d’être attentif à votre état de santé jusqu’à 3 semaines après votre retour.
En cas de doute (fièvre, douleurs articulaires intenses, fatigue, éruptions cutanées...), contactez rapidement un médecin en précisant avoir séjourné dans une zone où circulent les virus
L’apparition sur un territoire d’une maladie vectorielle (transmise par un vecteur) commence par l’arrivée d’une personne ou d’un animal porteur de la maladie, en provenance d’une zone du monde où elle sévit. Si cette personne ou animal se fait piquer par un moustique vecteur, celui pourra sous quelques jours transmettre à son tour la maladie en piquant d’autres personnes ou maladies.
Ce sont donc les voyageurs, les animaux d’importation ou les oiseaux migrateurs provenant de zones d’endémie qui constituent les publics sensibles, devant faire l’objet d’une surveillance approfondie dans les jours suivant leur arrivée sur le territoire.
Pour les voyageurs, en cas d’apparition de symptômes comme de la fièvre, des douleurs articulaires, etc. il est important de consulter un médecin en indiquant la zone de voyage, afin que celui-ci identifie si elle se situe en secteur de circulation de la maladie. Au besoin, il pourra prescrire des analyses complémentaires (prise de sang par exemple) pour rechercher les agents pathogènes et donner des conseils de prévention pour éviter de se faire piquer (mettre du répulsif, porter des habits longs, etc.). En cas de confirmation de la maladie, le médecin prévient l’agence régionale de santé, via le Point focal régional (lien vers PFR), afin qu’elle mette en œuvre les mesures pour éviter la contamination d’autres personnes.
Les animaux font également l’objet de surveillance. Par exemple, les chevaux peuvent, comme l’homme, être infectés par la fièvre du Nil et l’apparition de symptômes spécifiques, connus des vétérinaires, peuvent alerter sur la possible circulation du virus. Il en est de même des oiseaux notamment migrateurs, dont la mortalité peut être la traduction d’une circulation virale.
Elle consiste à suivre la dynamique d’implantation des moustiques vecteurs de maladies. Les moustiques ont besoin pour se développer de conditions de températures et de vie favorables, en particulier la présence d’eau. Les différentes espèces de moustiques n’ont pas forcément les mêmes types d’habitat ou horaires pour piquer. Certains ont besoin de grandes mares, de bassins ou étangs lorsque d’autres peuvent se développer dans une simple flaque, d’autres piquent à l’extérieur des habitations, de nuit lorsque certains préfèrent piquer au lever du jour ou la tombée de la nuit et se protègent à l’intérieur des logements.
L’anophèle, moustique vecteur du paludisme est présente en Corse et son implantation est suivie. Le moustique tigre Aedes albopictus, s’est implanté en Corse en 2007 et depuis n’a cessé sa progression puisqu’il a colonisé depuis plus de 98% des communes de Corse. (joindre rapport de surveillance entomologique 2019) Il est actif, selon les secteurs, les conditions météorologiques, l’altitude généralement entre avril et novembre. En dehors de cette période, il est en diapause, c'est-à-dire qu’il est présent sous forme d’œufs et ne constitue pas de risque de transmission de maladies.
En application du Code de santé publique, l’agence régionale de santé est chargée d’assurer, en lien avec des opérateurs qu’elle aura désigné, la surveillance entomologique des moustiques vecteurs de maladie.
Lorsqu’une personne présente des symptômes compatibles avec une arbovirose (dengue, chikungunya, zika…), le médecin l’interroge sur son parcours les jours précédant l’apparition des symptômes, pour savoir, en particulier si elle a voyagé dans une zone à risque de transmission de la maladie. Si tel est le cas, le médecin pourra prescrire des analyses pour confirmer ou non l’infection. Dans l’attente des résultats, des conseils sont prodigués à la personne malade, pour éviter qu’elle ne se fasse piquer par des moustiques et transmettre ainsi la maladie.
Si les résultats sont positifs et confirme le fait que la personne est porteuse d’une arbovirose, le médecin ou le laboratoire contacte sans délai l’agence régionale de santé, qui identifie, à partir du parcours de la personne malade depuis qu’elle a les symptômes, les lieux qui nécessite une intervention des services de démoustication, afin d’éliminer les moustiques adultes et éviter la propagation de la maladie. Sous quelques heures, les équipes de démoustication réalisent une visite de terrain, pour identifier la présence de moustiques vecteurs, l’existence de gites et calibrer les moyens de traitement nécessaires au secteur. Ensuite, elles réalisent, sous l’autorité du préfet et de l’ARS, avec le concours des collectivités et le cas échéant des forces de l’ordre, les opérations de traitement, pour éliminer les moustiques adultes, les larves et supprimer les gites à moustiques. Le traitement utilisé (deltamétrine ou équivalent) est conforme aux normes en vigueur, mais nécessite néanmoins des précautions pour éviter d’exposer le public. Ainsi, il est recommandé de fermer les fenêtres, de couvrir les aliments, lorsque le traitement est réalisé dans le voisinage.
N'hésitez pas à télécharger (clic droit sur la vidéo) et partager largement cette vidéo !